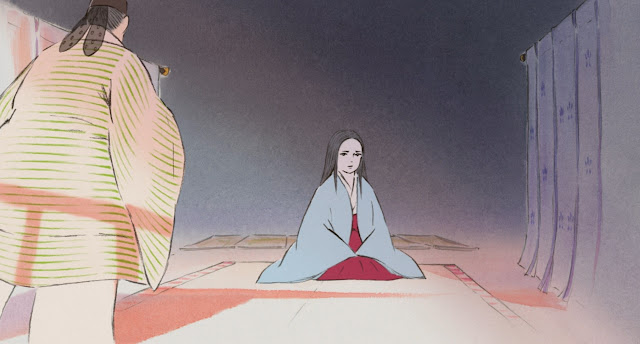Le Dit du Genji réussit particulièrement bien sur deux points que je trouve
essentiels dans tout bon roman : d’un côté la peinture de
personnages individualisés, dont nous comprenons intimement les sentiments, les
motivations, les contradictions aussi, et pour lesquels nous ressentons, à
défaut de sympathie, au moins une certaine empathie ; de l’autre, la
capacité à parler avec justesse des expériences essentielles et universelles de
l’existence humaine, à savoir la mort, le temps qui passe, les souffrances
liées aux passions humaines ou aux coups brusques, aléatoires, de la Fortune.
Si Le Dit du Genji
est un roman parmi les plus accomplis de la littérature, toutes époques et
cultures confondues, c’est qu’il s’agit d’abord et avant tout d’un roman
profondément humain qui, malgré la différence parfois considérable des mœurs
entre celles d’aujourd’hui et celles de la Cour des Heian au XIe siècle de
notre ère, raconte d’abord et avant tout des situations, des sentiments que
par-delà nos différences culturelles, raciales, nous avons, êtres humains, tous
éprouvé ou éprouverons au cours de notre propre existence. D’où l’étonnante
« modern[ité] » de ce roman dont s’émerveille à juste titre René
Sieffert, le traducteur français du Genji, et qui fait que je ne
me suis guère senti dépaysé malgré la distance culturelle et temporelle
importantes, la majeure et redoutable difficulté du roman reposant comme je
l’ai déjà dit dans un premier article sur le choix de Murasaki de ne pas nommer
directement ses personnages (voir mon article à ce sujet qui devrait grandement faciliter la lecture du roman pour ceux qui nourriraient quelque appréhension à l’aborder). En effet, nous avons davantage l’impression de lire un roman européen
du XIXe siècle, et l’art du roman de Murasaki n’est pas sans
rappeler celui de Flaubert, dans lequel l’auteur n’intervient guère pour juger
directement sur le plan moral ses personnages, se contentant d’exposer comment
pense et agit tel personnage, et nous laissant à nous lecteur le soin de juger
par nous-mêmes les innombrables êtres peuplant le roman.
Ce préambule
posé, Le Dit du
Genji se caractérise essentiellement par l’envie
récurrente de ses personnages de se
détacher du monde matériel dont, au fil des années qui passent, de la
vieillesse qui se fait inéluctable, de la mort de leurs proches, ils ressentent
avec une acuité croissante les souffrances qui y sont intrinsèquement liées,
mais aussi la vanité ultime, et l’extrême difficulté qu’il y a, malgré ce
constat qui se fait de plus en plus douloureusement lucide, à s’en détacher,
liée principalement aux êtres qui leur sont chers et qui dépendent d’eux. Ce
constat désenchanté, amer, sur le monde humain, lieu de perpétuels soucis et
souffrances, n’est il est vrai guère novateur, et presque tous les grands
romanciers et philosophes parviennent à peu près à une telle conclusion, plus
ou moins explicitement, dans leurs œuvres, bien que le degré de désenchantement,
de résignation, varient toutefois d’un auteur à l’autre. Pour ce qui est du Genji, cette vision des choses provient surtout
de la religion bouddhiste, religion dominante de l’époque, et dont les
pratiques et croyances imprègnent fortement celles des personnages : constatation
de la vanité ultime du monde, à l’image du jeune Bouddha sortant de son palais,
mais aussi, sur un plan plus discutable à titre personnel, la notion de karma,
selon laquelle un être mène une succession de vies liées étroitement entre
elles, qui peuvent paraître globalement mortifères (nos souffrances seraient
liées aux actions mauvaises d’une vie antérieure, ou celles commises dans notre
vie présente auraient des répercussions néfastes pour notre vie à venir,
l’obsession de cette dernière étant particulièrement prégnante) ou parfois, je
trouve, réconfortantes (l’idée notamment qu’un amour perdure et nous permette de retrouver les
êtres qui nous sont chers dans nos vies futures).
Mais là où Le Dit du Genji se distingue d’autres romans aboutissant au même constat pessimiste de la vanité du monde,
c’est dans son aspect émotionnel particulièrement poignant : Murasaki aborde,
écrit certes abondamment sur le thème de l’impermanence (ou la prise de
conscience du caractère éphémère des êtres et choses), thème lancinant qui
revient avec insistance tout au long du roman, mais elle le fait avec une émotion poignante, liée à la réussite de la
caractérisation des personnages qui nous rend leur mort d’autant plus
poignante et saisissante. Le Genji, en tant que personnage principal, est celui
qui traversera le plus souvent cette expérience du deuil : c’est à travers
elle qu’il prendra conscience, de manière croissante, de la vanité du monde, et
sa souffrance ne fera qu’augmenter à mesure que les êtres qu’il perd lui sont
plus chers, jusqu’à la perte ultime de la femme qu’il a le plus aimée,
Murasaki, qui clôt symboliquement son arc narratif et sa vie, n’ayant plus de
raison véritable de vivre, d’autant plus qu’il n’a pas eu d’enfants avec elle.
Voici par exemple le passage de la
mort d’Aoi, un des premiers temps forts du roman :
De voir une si belle personne [la femme du Genji, Aoi] à ce point affaiblie et rongée par le mal, étendue là entre la vie et la mort, était un spectacle pitoyable et douloureux. Sa chevelure, répandue sur l’appuie-tête sans que la moindre boucle en fût dérangée, était d’une beauté si parfaite qu’il [le Genji] la contemplait, stupéfait, se demandant quel défaut il avait bien pu lui trouver pendant toutes ces années.– Je vais présenter mes devoirs à l’Empereur Retiré [le père du Genji] et je reviendrai aussitôt. Si j’avais pu vous voir ainsi, sans cérémonie, j’en eusse été fort heureux, mais comme la Princesse [la mère d’Aoi] était sans cesse à vos côtés, je craignais d’être importun et je m’en suis abstenu par une discrétion qui dut vous paraître cruelle. Désormais, tâchez de reprendre courage et regagnez votre place habituelle ! C’est un peu parce qu’elle vous traite comme une enfant que vous vous complaisez dans cet état ! dit-il encore, et quand il la quitta, superbe dans son costume somptueux, de sa couche elle le suivit d’un long regard, plus appuyé que jamais.Comme c’était le jour où le Conseil devait décider des nominations d’automne, le Ministre [le père d’Aoi] se rendait au Palais, lui aussi, et ses fils, qui espéraient voir leurs efforts récompensées et ne voulaient s’éloigner de lui, tous sortirent à sa suite. La résidence était presque déserte et silencieuse quand soudain la malade, reprise par ses étouffements, se mit à souffrir atrocement. L’on envoya aussitôt au Palais, mais déjà elle ne respirait plus. Tous quittèrent le Palais en hâte, et bien que ce fût la nuit des promotions, ce fut comme si cet accident avait tout ravagé. […] Ce coup fatal, survenant au moment où, soulagés, ils la croyaient sauve, avait frappé de stupeur les habitants de la résidence. De toute part affluaient les messagers envoyés aux nouvelles, mais ils ne trouvaient personne pour les recevoir, dans l’agitation générale, et la douleur des parents offrait un terrible spectacle. Se souvenant que plusieurs fois, sous l’emprise de l’esprit, elle était restée sans connaissance, ils restèrent deux ou trois jours à la veiller, sans même toucher à son appuie-tête, mais comme peu à peu l’aspect du corps se modifiait, ils durent enfin se rendre à l’évidence, au désespoir d’un chacun. À la peine du Sire Général s’ajoutait un autre sujet d’affliction encore, de sorte que, pénétré de la cruelle vanité de ce monde, les condoléances venues des lieux les plus exaltés ne faisaient qu’aviver son ennui. […] On leur conseilla d’essayer des conjurations plus puissantes, et ils les tentèrent toutes dans l’espoir qu’elle pût revenir à la vie, si profond était leur trouble malgré l’altération visible du corps, mais tout était vain et, après quelques jours, en désespoir de cause, on l’emporta à Toribéno, avec les signes d’une douleur extrême. […] Le Ministre, effondré, pleurait, honteux de survivre :– Au terme d’une si longue vie, être précédé dans la mort par une enfant dans la fleur de l’âge, quel crève-cœur ! disait-il, et son entourage le considérait avec affliction.Tout au long de la nuit se déploya la pompe des cérémonies, mais, vers le point du jour, le Prince se retira, abandonnant à regret la vaine dépouille. Des funérailles sont chose banale certes, mais sans doute parce qu’à l’exception d’une seule fois, il n’en avait guère l’expérience, il en avait été affecté de façon peu commune. C’était passé le vingt du huitième mois, quand le croissant de lune luit à l’aube, et l’aspect du ciel incitait à la mélancolie ; la vue du Ministre, errant dans les ténèbres de son cœur, ajoutait à son affliction ; contemplant le ciel, il murmura :Je ne sais lequelest la fumée qui montadu bûcher funestemais la vue de ces nuagesm’emplit de mélancolieRevenu à la résidence, il ne put trouver le sommeil ; évoquant les souvenirs de toutes ces années, il suivait le fil de ses pensées : comment avait-il pu se dire tranquillement qu’elle finirait bien par le voir d’un œil plus favorable, et par ses intrigues frivoles lui infliger de si cruels tourments. Sa vie durant, et jusqu’à son dernier jour, elle avait pu le tenir pour un être vil et méprisable ! Ainsi se reprochait-il bien des choses, mais tout cela était vain désormais. (p. 248 à 250, livre 9)
Ou encore, plus loin, les derniers instants de
Fujitsubo :
L’Impératrice entrée en religion était souffrante depuis le début du printemps ; à la troisième lune son état empira, et l’Empereur [son fils, Reizei] lui rendit visite. Au moment de la disparition de l’Empereur Retiré [son père, Kiritsubo], il était tout enfant encore et ne l’avait donc pas ressentie profondément, mais cette fois il avait un air si affligé que cette Princesse en fut elle aussi tout attristée.– J’ai toujours pensé que cette année-ci me serait fatale, mais comme mes souffrances n’étaient pas trop terribles, je me contenais, car je craignais que si je laissais paraître que je savais ma fin prochaine, l’on ne s’inquiétât de moi plus que de raison ; aussi ai-je à dessein donné moins d’importance que d’ordinaire aux pratiques destinées à assurer mon salut. Je pensais certes me rendre au Palais, afin de m’entretenir paisiblement avec vous des choses du passé, mais trop brefs étaient les répits que me laissaient mon mal, et je voyais à regret s’écouler les jours dans un morne ennui.Elle parlait d’une voix très faible. Elle était dans sa trente-septième année ; cependant, elle avait encore toute la splendeur de sa jeunesse, et l’Empereur la contemplait avec regret et tristesse. Alors qu’elle était à un âge où certaines précautions s’imposaient, et tandis que lui-même déjà s’inquiétait de ce qu’elle vivait tous ces mois dans un constant abattement, elle n’avait donc eu recours à nulle précaution particulière, se disait-il avec amertume. Et c’était maintenant seulement que, surpris et effrayé, il s’avisait de faire procéder à tous les rites nécessaires. Le Ministre Genji lui aussi était consterné de ce que, des mois durant, l’on n’eût pris garde à ce que l’on avait pris pour une maladie banale. Tenu par l’étiquette, l’Empereur bientôt se retira, dans l’affliction générale. La Princesse, qui souffrait cruellement, ne lui avait fait aucune révélation, mais en son for intérieur, elle ne cessait de remuer mille pensées : altière avait été sa destinée, et sa fortune à nulle autre pareille, et pourtant, elle seule le savait, plus que toute autre elle avait connu de secrets tourments. L’idée que l’Empereur ne se doutait, fût-ce en rêve, de la vérité, la torturait lorsqu’elle le voyait, et elle restait persuadée que ses remords à ce propos suffiraient à faire obstacle à son salut. […]– Je vous sais gré d’avoir, conformément aux ultimes volontés de l’Empereur Retiré, veillé aux intérêts de sa Majesté, mais je regrette amèrement à présent d’avoir attendu placidement qu’une occasion se présentât pour vous exprimer la particulière gratitude que je vous dois !Ces paroles de la malade, prononcées d’une voix faible, lui étaient parvenues indistinctes : incapable de trouver une réponse, il se mit à pleurer piteusement. Il s’avisa que ceux qui le voyaient, pouvaient se demander pourquoi il était à ce point désemparé, mais la manière d’être qui, toujours, avait été celle de la Princesse, son état qui, même aux plus indifférents, inspirait regret et pitié, voilà qui échappait à la volonté humaine, aussi rien ne pouvait-il la retenir en ce monde, et le sentiment l’envahit que tout était vain désormais.– Encore que je n’eusse guère d’influence, de tout temps j’ai estimé, dans la mesure de mes moyens, devoir veiller sur sa Majesté ; or, déjà par le trépas du Grand Ministre [son beau-père, père d’Aoi] profondément affecté, me voici, quand je vous vois ainsi, jeté dans un trouble tel que j’ai le sentiment qu’il ne me reste plus guère à vivre en ce monde !Tandis qu’il lui parlait de la sorte, ainsi qu’une lampe qui s’éteint, elle avait cessé de vivre ; alors il s’abandonna aux tourments d’une vaine affliction. […] Le monde entier retentit du bruit des funérailles, et il n’était homme qui n’en fût affligé. Les gens de Cour uniformément ne portaient plus que du noir, et ce fut une fin de printemps sans éclat. […] Le soleil couchant resplendissait, et à l’endroit où se détachait sur le ciel la ramure des arbres de la crête, un mince nuage s’étirait, grisâtre, qui en temps ordinaire n’eût pas retenu son attention, mais qui à cette heure le plongeait dans la mélancolie.Ce mince nuagequi s’étire sur la cimeau soleil couchantsa couleur confondra-t-ilavec ma manche pensiveMais à quoi bon, puisque nul ne le pouvait entendre ? (p. 459 à 461, livre 19)
L’aspect
émotionnel poignant du Dit du Genji ne
tient cependant pas uniquement au thème de la mort : Murasaki excelle
aussi dans les scènes de séparation entre les êtres chers, que l’on retrouve en
particulier dans le cas de la famille d’Akashi : d’abord le départ des
femmes pour se rapprocher du Genji, laissant derrière elles le Patriarche, qui
se coupera par la suite définitivement du monde en s’isolant dans une montagne
difficilement accessible. Ces personnages sont mes préférés de tout le roman
(avec Murasaki, le personnage) et l’auteure nous dépeint les difficiles
épreuves qu’ils traversent avec une justesse émotionnelle rarement atteinte
dans toute la littérature. Enfin, ce qui fait aussi la force émotionnelle
exceptionnelle du Genji, ce sont certes les thèmes classiques du
temps qui passe, de la mélancolie ressentie vis-à-vis du passé, de la jeunesse
d’antan regrettée, mais surtout l’art, la manière dont Murasaki l’aborde, avec
d’un côté des personnages dont la vie nous est devenue proche, chère, à mesure
que le roman avance (et dont la longueur leur donne une ampleur, une vie, que
seul un très long roman parvient à leur conférer), et de l’autre la subtilité
et délicatesse dont les personnages ressentent ce passage du temps, par la
contemplation de la nature ou la musique, que Murasaki décrit avec un talent
poétique magnifique.
Lorsqu’elle [la dame d’Akashi, amante du Genji] comprit qu’elle ne pouvait se dérober et que le départ était imminent, la dame songea avec émotion qu’il lui fallait s’éloigner de ces rivages où tant d’années elle avait vécu, et elle s’affligeait de l’abandon dans lequel se trouverait le Religieux [le père de la dame d’Akashi] qui allait rester là, seul. Pourquoi donc, se disait-elle, lui fallait-il ainsi épuiser la somme de tous les soucis ? Et elle en venait à envier celles sur qui jamais la rosée des faveurs du Prince ne s’était répandue. Ses parents étaient fort satisfaits de l’accueil qu’il lui réservait à la capitale, heureuse fortune qui répondait aux vœux que, des années durant, ils avaient formulé jour et nuit ; le père cependant éprouvait une affliction insoutenable à l’idée qu’il devait vivre désormais sans les voir, et dans son abattement ne faisait que répéter du matin au soir :– Est-il possible que je vive quand je serai privé de la vue de la petite demoiselle [sa petite-fille] ?Dame la mère de même faisait pitié. Depuis des années ils vivaient séparés, chacun dans sa retraite ; si donc elle restait là, sur qui pourrait-elle s’appuyer ? Il suffit de relations superficielles avec des gens sans conséquence pour créer des habitudes qui rendent pénible l’heure de la séparation, à plus forte raison avait-elle le cœur serré à l’idée de s’éloigner soudain de cet homme avec qui, malgré le peu de confiance qu’inspiraient les bizarreries de son caractère, elle s’était promis de passer le reste de ses jours en ces lieux qui devaient être sa demeure ultime en ce monde. Les jeunes personnes qui trouvaient ce séjour bien monotone à leur gré, étaient heureuses de revenir à la capitale, et pourtant la pensée que jamais sans doute elles ne reverraient ces rivages enchanteurs, mouillait leur manche autant que les vagues qui venaient du large.C’était en la saison d’automne, qui rendait doublement poignant le départ ; à l’aube du jour dit, un vent frais soufflait, les insectes criaient sans répit ; elle regardait dans la direction de la mer tandis que le Religieux, levé avant matines, faisait ses dévotions en reniflant. […] La petite demoiselle était si belle qu’elle lui semblait le joyau qui illuminait ses nuits […], il se demandait comment il pourrait vivre s’il devait rester, fût-ce un seul instant, sans la voir, et il ne pouvait contenir ses larmes :Alors que nos routesvont se séparer je priepour son but lointainmais je ne puis étoufferles larmes de la vieillesse […]Dame la nonne répondit :Ce fut avec vousque de la Ville je vinsor cette fois-cime faudra-t-il donc errertoute seule par la landePour verser des larmes, elle avait d’excellentes raisons ! Elle songeait à toutes ces années pendant lesquelles elle avait partagé son destin, et à l’idée de retourner dans un monde qu’ils avaient rejeté, en se fiant à d’incertaines promesses, elle en éprouvait la vanité.La dame enfin :Un jour en ce mondede nouveau nous verrons-nousaprès ce départpuisque rien n’est assurépourquoi ne point espérer (p. 435 à 437, livre 18)
Pour
résumer et poursuivre l’analyse sur le Genji,
voici donc un roman avant tout profondément humain, abordant les aspects
essentiels de la vie humaine de manière très émouvante, mais humain aussi dans le sens où il nous présente des personnages complexes, emplis de
contradictions, au premier rang desquelles leur difficulté à se détacher du monde
matériel, bien que tous en éprouvent, à des degrés différents, la vanité
ultime. Cette volonté de retrait se manifeste sous plusieurs formes : la
principale est l’entrée dans la vie religieuse, symbolisée par la tombée de la
chevelure, processus irrémédiable semble-t-il, et qui signifie surtout la fin
de tout contact avec le monde extérieur, et en particulier avec les gens qui
nous sont proches (bien que certaines exceptions semblent possibles, comme
lorsque Suzaku revient pour sa fille, la Princesse Troisième, ou cette dernière
qui garde une forme de contact avec son fils, Kaoru) ; l’exil volontaire
(comme le cas de la famille d’Akashi ou du prince d'Uji) ; ou de manière plus extrême, le
suicide, mais qui est semble-t-il mal vu du point de vue religieux, mais qui
sera néanmoins considéré par certains personnages (par la dame d'Akashi, mais surtout par Ukifune, la dernière fille, illégitime, du prince d'Uji) comme la seule issue à leurs
tourments incessants.
Ce qui rend le
roman d’autant plus passionnant, c’est l’objectivité de l’auteure, qui ne
tranche pas définitivement la question de la nécessité du retrait du monde, bien
que le ton se fasse résolument plus pessimiste dans la partie d’Uji (les dix derniers chapitres du roman)
où, plus que jamais, le monde humain est décrit comme un lieu avant tout de
souffrances, peu enviable, que les protagonistes auxquels notre sympathie va
perçoivent comme un trouble à leur repos et où ils sont en proie à leurs
pulsions sexuelles (pour les hommes) ou la proie du désir masculin (pour les
femmes).
Rester dans le monde signifie donc en
définitive aller au-devant de nouvelles souffrances, tourments sans fin, tandis
que le monde religieux, bien qu’il semble préférable car délivré des
souffrances terrestres, se caractérise néanmoins par l’ennui, la monotonie (ce
qui fait inévitablement penser à Schopenhauer, dont la philosophie rappelons-le
est fortement inspirée des philosophies bouddhistes et hindouistes), mais
aussi, dans le cas du Genji, la séparation avec Murasaki, séparation qu’il ne peut
supporter en son for intérieur et qui fait qu’il ne peut se résoudre à une
telle extrémité malgré sa lassitude croissante vis-à-vis du monde à mesure
qu’il vieillit, et malgré aussi les supplications de cette dernière, qui eût
voulu se faire nonne pour mettre fin aux tourments intérieurs qui la rongent.
Cette tension
existentielle, résultant d’un côté d’un dégoût croissant vis-à-vis d’un monde perçu
comme instable, lieu de souffrances perpétuelles auquel nous aimerions échapper,
et de l’autre un certain attachement à ce monde, ne serait-ce que pour les
personnes qui nous sont chères, et pour l’amour desquelles nous continuons
malgré tout à subir ces souffrances, n’est-elle pas de tout temps une
expérience humaine universelle, que nous sommes tôt ou tard amenés à ressentir
chacun et chacune d’entre nous ? C’est cette tension, et l’intensité avec
laquelle elle est représentée, qui fait la principale qualité et
caractéristique du Dit du Genji, en
tout cas celle que je retiens principalement de ma première lecture du roman.
Ainsi, le Genji est incapable de
renoncer au monde, car il pense sans cesse aux femmes dont il a en quelque
sorte la charge, et qui seraient démunies pour la majorité d’entre elles sans
sa protection. Mais surtout l’obstacle majeur et principal, au final, s’avère
être son incapacité à se détacher de Murasaki, qui prouve concomitamment le
grand amour qu’il lui attache, et la mort de cette dernière aura d’ailleurs par
conséquence la mort du Genji, nonobstant les femmes qui lui survivront, Genji
ayant en quelque sorte perdu sa raison de vivre avec la mort de celle qu’il a
le plus aimée. Le Dit du Genji est à
ce sens une des plus belles histoires d’amour jamais écrites, d’autant plus
belle sans doute par le côté tragique de cet amour, qui ne connaîtra guère de
repos, entre un Genji libertin, dont le désir se porte sur toute femme excitant
sa curiosité, mais qui au final lui serviront de comparatif constant avec
Murasaki, lui rappelant au final à quel point elle se distingue de ses rivales par
ses qualités incomparables, et une Murasaki qui doute par intermittences de
l’amour que le Genji lui porte au gré de ses infidélités, bien qu’elle sache
qu’elle occupe dans son esprit la première place, mais dont elle redoute la
déchéance, par l’action conjointe de sa propre vieillesse et de la jeunesse de
ses rivales. Les tourments, souffrances, de Murasaki sont d’autant plus
poignantes qu’elle s’ingénie à les minimiser, à ne pas les faire voir à celui
qu’elle aime, bien que ce dernier devine, çà et là, les souffrances qu’il lui
inflige et se les reproche amèrement à lui-même.
Voici par exemple le Genji, « forcé » de passer la nuit avec sa dernière concubine qui lui a été imposée presque de force par son demi-frère, l’Empereur Retiré Suzuku, la Princesse Troisième, et qui se tourmente de ce qu’en pensera Murasaki, qui lui cache sa souffrance intérieure du mieux qu’elle peut :
Voici par exemple le Genji, « forcé » de passer la nuit avec sa dernière concubine qui lui a été imposée presque de force par son demi-frère, l’Empereur Retiré Suzuku, la Princesse Troisième, et qui se tourmente de ce qu’en pensera Murasaki, qui lui cache sa souffrance intérieure du mieux qu’elle peut :
– Pour cette nuit seulement, veuillez me pardonner, car je dois observer la coutume. Si par la suite il devait m’arriver de vous manquer encore, croyez bien que ce serait à mon corps défendant. Cela dit, d’un autre côté, si l’Empereur Retiré venait à avoir vent de quelque chose…, dit-il, et les sentiments mêlés qui agitaient son cœur paraissaient le faire souffrir.Elle eut un léger sourire :– Quand vous-même me semblez incapable d’en décider franchement, comment pourrais-je, moi, à plus forte raison, trancher de je ne sais quelle coutume à observer ? dit-elle.Et comme elle avait ainsi coupé court, jugeant apparemment inutile de poursuivre sur ce ton, confus et perplexe, il restait là, étendu, la tête appuyée sur la main ; elle attira à elle l’écritoire :Ce monde pourtantqui sans cesse sous nos yeuxchange et se transformej’avais cru pour l’avenirpouvoir lui faire confiance[…] quand il le lut, encore que les vers fussent des plus plats, il se dit qu’en effet c’était raison :Le fil de nos jourspeut se rompre à tout instantmais ce qui nous liede ce monde impermanentjamais ne suivra le sortcomme il ne pouvait se résoudre à se rendre là-bas, et qu’elle l’en pressait, lui faisant observer l’inconvenance qu’il y aurait à être en retard, il s’en alla, superbe dans son costume de soie souple qui répandait un parfum indiciblement suave ; et ce n’était certes point d’un cœur léger qu’elle le suivait du regard.Pendant des années, elle avait vécu dans l’appréhension d’une pareille mésaventure, et c’était maintenant, alors que, imaginant tout danger écarté, elle se croyait enfin à l’abri, qu’était survenu cet accident qui faisait l’objet de tous les racontars. Et de constater que, décidément, rien n’était assuré en ce monde, lui inspirait désormais de nouvelles craintes pour l’avenir. Or, cependant qu’elle s’efforçait de donner le change en demeurant impassible, les femmes qui la servaient ne cessaient de cancaner entre elles : […]Elle, toutefois, faisant mine d’ignorer ces récriminations et restait jusque tard dans la nuit à bavarder gaiement avec les femmes ; il lui déplaisait, en effet, que celles-ci fissent tant de bruit autour de cette affaire. […] si, contrairement à sa coutume, elle restait tard à veiller, ses femmes s’en étonneraient, lui susurrait le démon qui est au cœur ; elle entra donc dans son alcôve et revêtit ses effets de nuit, mais, en vérité, la tristesse de toutes ces nuits qu’elle passait solitaire l’accablait de plus belle ; au souvenir toutefois du temps de leur séparation, quand il se trouvait à Suma, elle se raisonnait : la seule chose qui lui importait alors était de savoir qu’il était toujours de ce monde, fût-il éloigné d’elle, et elle ne désolait et ne s’affligeait que pour lui, jusqu’à en oublier ses propres soucis ; que si, en cette occurrence, elle ou lui avait perdu la vie, leur histoire se fût arrêtée là… Le vent soufflait et la nuit était froide, et comme elle ne trouvait le sommeil, craignant que les femmes étendues près d’elle ne s’en étonnassent, elle n’osait remuer, ce qui ajoutait encore à son malaise. Le chant d’un coq s’éleva au cœur de la nuit, mélancolique. (p. 748 à 750, livre 34)
Le Genji, bien que préférant Murasaki
à toute autre, ne peut s’empêcher cependant de céder de temps à autre à son impétueux
libertinage, ce qui blesse profondément celle qu’il aime. Dans le même temps, la
sincérité de son amour est véritable, comme en témoigne la déclaration d’amour touchante
de simplicité qu’il lui fait, peu avant qu’elle ne tombe malade :
Elle avait caché sous son écritoire des exercices d’écriture qu’elle avait tracés d’une main dégagée, mais, les ayant découverts, il les retourna et y jeta un coup d’œil. Elle avait écrit sans recherche délibérée, d’une main sûre et fort agréable ; entre autres, un poème avait retenu son attention :Automne déjàserait-il si près de moipuisque sous mes yeuxla montagne au vert feuillagea changé de couleurÀ côté, il s’amusa à griffonner celui-ci :De l’oiseau d’eaules couleurs d’un vert plumagene sont altéréesmême si du lespédèzel’apparence n’est plus la mêmeQu’elle s’ingéniât, quel qu’en fût le propos, à effacer, comme si de rien n’était, la trace des soucis que malgré elle il devinait à son air, la lui rendait plus chère et plus émouvante encore. Ce soir-là pourtant, comme il alla être libre des deux côtés, il s’inventa une raison impérieuse de se rendre sur les lieux de sa discrète équipée. La chose était parfaitement inconvenante, et il s’adressa de vifs reproches, mais ne parvint point à s’en dissuader. (p. 762, livre 34)
– Ah, si vous pouviez enfin accéder à la requête [celle de devenir nonne] que naguère je vous ai soumise…– Voilà qui m’est proprement impossible ! De quoi me servirait-il, en ce cas, de vivre plus longtemps, séparé que je serais de vous pour toujours ? C’est une vie banale et sans relief que je mène à vos côtés, mais rien ne saurait passer la simple la joie que j’éprouve à la mener ainsi près de vous, la nuit et le jour. Et je voudrais que, jusqu’au bout, vous prissiez la mesure de mon indéfectible affection, dit-il seulement.De constater qu’il n’en démordrait point, elle avait le cœur serré, et, voyant avec émotion ses yeux embués de larmes, il s’empressa de parler d’autre chose. (p. 825, livre 35)
Enfin, le dernier
point qui me semble primordial dans le Genji
est la fragilité, l’inconstance de la condition humaine, soit par les coups du
sort (ou de la Fortune), soit par la propre inconstance de l’homme. Cet aspect est
surtout prégnant en ce qui concerne les femmes du roman, qui sont au final le
véritable cœur du roman. Ce sont en effet leurs tourments, leurs souffrances,
qui sont les mieux représentées dans le détail, les plus poignantes aussi, en
raison de leur position dans la société les rendant extrêmement dépendantes des
hommes, dépendance d’autant plus précaire que le cœur de l’homme est peint dans
sa brutalité et dans son extrême versatilité. Ce dernier aspect était certes atténué
lorsque nous sommes en la présence du Genji, personnage certes versatile,
libertin, mais qui au final n’en aimera vraiment qu’une et s’attache à prendre
soin de toutes les femmes avec lesquelles il a été en relation intime, et dont
la « brutalité » au regard de son insistance face aux femmes qui lui
résistent est certes difficilement défendable, mais l’inconvenance du Genji
paraît presque dérisoire par rapport aux autres hommes du roman, qui ont
beaucoup moins de scrupules que lui pour parvenir à leurs fins, et dont
l’attachement est beaucoup plus superficiel que celui reliant le Genji avec
toutes ses maîtresses présentes et passées, lui qui voyait en chacune d’elles
une beauté, une singularité, qui les rendait dignes de son amour et/ou de sa
compassion. Que l’on voit par exemple comment Genji prend soin de
Suétsumu-hana, la « laide » princesse de Hitachi, avec qui il restera
en contact et qu’il sauve littéralement de la misère et de l’abandon dans
lesquels elle était progressivement tombée, alors qu’aucun autre homme sans
doute n’y eût davantage prêté attention. Même celles qui lui résisteront
jusqu’au bout sont amenées à prendre conscience de la nature exceptionnelle du
Genji, qui malgré ses multiples défauts, n’en demeure pas moins un homme bon,
compatissant. Quel contraste, quel gouffre même y a-t-il entre les manières du
Genji vis-à-vis des femmes, et celles de Yugiri (son propre fils, vis-à-vis de
la Princesse Seconde veuve de son meilleur ami de surcroît !), celles de
Higekuro (vis-à-vis de Tamakazura), ou celles de Niou, petit-fils du Genji et
un des personnages principaux de la partie d’Uji (vis-à-vis d’Ukifune) !
 |
 |
| 2 captures de Kwaidan (Kobayashi, 1964), qui pourraient illustrer l'état de délabrement de la demeure de Suétsumu-hana, dont la description est très imagée. |
Si
les hommes sont eux aussi soumis aux coups de la Fortune, à des renversements
de situation, tels l’épisode exemplaire de l’exil et de la disgrâce du Genji à
Suma, ce sont surtout les femmes qui y sont le plus soumises, et dont la
situation est des plus instables : qu’adviendra-t-il d’elles une fois leur
protecteur (père, mari, sœur…) décédé ? Les parents en particulier se
tourmentent pour leur progéniture féminine, dont ils s’inquiètent de l’absence,
ou de la faiblesse, des appuis dont elles disposeront une fois leur mort, ou
leur conversion religieuse (qui s’apparente presque à la mort, en tout cas
synonyme de mort sociale) survenue. Le lignage, l’entourage dont disposeront
tel (c’est le cas notamment du Genji, dont le sort est aussi source de
tourments pour son père, à juste titre d’ailleurs) ou telle (les exemples
féminins sont innombrables, entre la Princesse Troisième, Fujitsubo, les filles
du Prince d’Uji etc.) de leurs enfants est une source de préoccupation
constante pour leurs parents, a fortiori lorsqu’il
s’agit d’une enfant dont la mère dispose elle-même d’un lignage faible, et dont
la mort du père l’expose souvent à la rancune, le ressentiment, ou à
l’indifférence des femmes rivales de leur mère biologique. Les codes, les
mœurs, pour aggraver le tout, rendent la condition féminine extrêmement
difficile et pénible, et rien n’est moins enviable au final qu’être une femme à
cette époque, pourrait-on dire : la bienséance voulant qu’il faille
répondre à toute lettre bien tournée, l’extrême précaution dont il faut user
face aux hommes (en particulier éviter d’être vue par eux, mais aussi la
complicité, la duplicité des suivantes qui prennent souvent fait et cause pour
l’insistant soupirant), la présomption de culpabilité si les circonstances
laissent penser ou présager d’une « légèreté » de la part de la femme
(le cas de la Princesse Seconde face à l’insistance de Yugiri)…
Le Dit du Genji a indubitablement un
certain côté féministe engagé, mais de la meilleure sorte : là encore cela
tient de l’objectivité dont fait preuve Murasaki, qui n’intervient pas
directement dans le roman pour prononcer des jugements, mais qui se contente de
représenter les comportements humains, et leur répétition, les échos que nous
percevons entre les différentes situations, nous permettent de voir à quel
point le rapport de forces est déséquilibré au détriment des femmes, à quel
point aussi les hommes jouissent d’une certaine impunité, et à quel degré de
souffrances les femmes sont amenées de par le comportement brutal de leurs
soupirants.
La Princesse aînée, à plus
forte raison, en était troublée : le cœur du Prince était donc bien, comme
elle le craignait, changeant autant que l’herbe-de-lune ! Jusque dans sa retraite,
il lui était revenu que ces êtres qui avaient nom « hommes » étaient habiles
à manier le mensonge ; des récits que lui faisaient de leurs aventures d’autrefois
ses femmes, il ressortait qu’ils savaient vous abreuver de belles paroles pour vous
faire croire qu’ils vous aimaient quand il n’en était rien, mais elle avait pensé
que si, parmi les gens de rang infime, il pouvait en effet s’en trouver pour agir
de façon aussi vulgaire, dès lors que l’on avait à faire à des personnages de haute
naissance, la crainte de l’opinion devait leur inspirer une salutaire prudence ;
or il apparaissait manifestement qu’il n’en était rien. Le feu Prince déjà avait
été prévenu contre celui-là dont la frivolité était bien connue, et jamais il n’avait
envisagé de l’admettre dans son entourage proche ; le jeune homme toutefois
s’était, dans ses lettres, montré si profondément épris en apparence que, malgré
qu’elle en eût, elle avait fini par agréer ses visites, ce qui maintenant se révélait
désastreux. (p. 1149, livre 46)
 |
 |
 |
Pour résumer donc, Le Dit du Genji est un roman remarquable, et cela
tient de l’exceptionnelle émotion qui s’en dégage par rapport aux souffrances
et tourments des personnages, confrontés aux situations, aux dilemmes
universels que rencontre l’homme, peu importe l’époque et la culture dans
lesquelles il se trouve : la contradiction entre dégoût et attachement au
monde, l’expérience douloureuse de la séparation avec les êtres qui nous sont
chers, l’expérience aussi de notre propre inconstance et celle des autres.
Malgré tout, Le Dit du Genji est
aussi drôle par moments (les interventions discrètes et malicieuses de
l’auteure elle-même, rappelant sa condition d’écrivain-courtisan, ou tournant
en dérision les poèmes écrits par ses protagonistes ; le caractère comique
de Suétsumu-hana et de la fille rustique de To no Chujo, au livre 29,
p. 640-641 ; 645 à 647), mais surtout nous fait voir la beauté
autrement, en particulier dans l’exaltation de celle que l’on trouve dans la
nature (la lune et les fleurs en particulier) et les arts (la musique
essentiellement comme consolation et exaltation mélancoliques).
 |
| 2 captures de Gate of Hell (Kinugasa, 1953). La seconde capture représente un koto, cithare à 13 cordes souvent évoquée dans le roman. |
 |
| De haut en bas : une flûte de Koma (komabue), un luth japonais (biwa) et un orgue à sbouche (shô) |
 |
| De haut en bas, 3 fleurs souvent citées : le corète, la glycine, le deutzie. |
 |
| Les cerisiers (haut) et pruniers (bas) en fleur. |